PSYBERNÉTIQUE
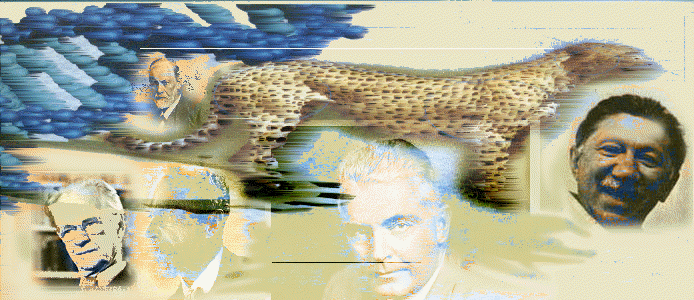
PSYBERNÉTIQUE
|
RÉPONSES1. Le ça: - La fréquentation
de l'université est une source de tension pour Jules parce qu'elle va à
l'encontre du principe de plaisir. Jules libère cette tension sous différentes
formes, notamment par des pensées spontanées -- comme dans l'expression «forcé
à étudier» -- et par des pensées agressives -- comme lorsqu'il se choque
face aux reproches déguisés de ses parents ou lorsqu'il avait voulu une fois
tout casser dans la maison et avait même pensé que ce serait bien mérité
pour ses parents. Le moi: - Il est régi par le principe de la réalité et tente ainsi de satisfaire les besoins du ça -- qui vit des tensions désagréables vis-à-vis de l'université -- et les besoins du surmoi -- qui se manifeste sous la forme de l'idéal du moi ou de la conscience morale. Jules semble ainsi avoir trouvé un juste compromis entre les pulsions destructrices du ça et les exigences du surmoi en étirant indûment la durée de ses études. Le moi est aussi le lieu où siègent les mécanismes de défense et Jules veille à refouler ses pensées déplacées, comme lorsque l'expression «forcé à étudier» lui était venue à l’esprit ou lorsqu'il avait souhaité du mal à ses parents. Il se libère aussi des tensions destructrices par une activité acceptable qui consiste à démonter des moteurs dans le garage. Le surmoi: - Il juge les activités du moi en fonction tout d'abord de l'idéal du moi. Jules aimerait tant que ses parents soient fiers de lui, qui a délaissé ses intérêts personnels (mécanique automobile) pour leur faire plaisir. S'il continue à étudier c'est probablement à cause des pressions de l'idéal du moi. - Le surmoi juge aussi les activités du moi en fonction de la conscience morale. Ainsi, Jules s'en veut (culpabilité) d’avoir souhaité du mal à ses parents. 2. Le surmoi. Ambroise est sous la domination d'un idéal du moi très exigeant, hérité de ses parents très stricts. Ambroise ne peut être fier de lui que s’il arrive à se contrôler dans toutes les circonstances. D'autre part, il est aussi sous l’emprise d'une conscience morale très contraignante qui l'amène à avoir honte de certaines pensées et à se punir sévèrement lorsqu'elles surgissent. 3. Le rêve constitue l'expression symbolique et déguisée des désirs refoulés, ou idées latentes, qui constituent un tout cohérent. Toutefois, la censure vient semer la confusion en maquillant en quelque sorte ces idées latentes pour leur donner une forme plus acceptable, soit le rêve manifeste. Dans son rêve, Jules exprime des désirs refoulés, à savoir qu'il est probablement jaloux de l'affection que ses parents ont pour Tom et qu'il souhaite la disparition de ce dernier; il aimerait aussi que ses parents l'aiment pour ce qu'il préfère, soit la mécanique automobile. Ces deux désirs trouvent leur expression dans le rêve, mais de façon acceptable grâce à la censure. L'université est tout d'abord détruite en entraînant la mort de Tom, ce qui est improbable puisqu'il n’y est plus étudiant. Dans cet épisode, les désirs sont exprimés, mais on ne peut tenir Jules responsable de ces désirs ni même le soupçonner de les avoir eus. Jules réalise aussi que ses parents sont enfin fiers de sa passion, soit réparer les voitures. Dans cette situation, il a fait une bonne action qui ne peut être associée à la mort de Tom et il peut donc vivre cette fierté sans sentiment de culpabilité. 4. Il s'agit dans l'ordre de: • régression • sublimation puisqu'il poursuit un but supérieur • déni • formation réactionnelle • intellectualisation • projection |
Tuesday 08 August 2000
|